Le 17 février dernier, l’ouvrage « Classiques » est sorti en librairie. D’une écriture tendre et picturale, Laurent Galinon, son auteur, nous transmet sa passion des classiques, sensible et imagée. Biberonné à ces grandes messes du dimanche, il leur a toujours voué une fidélité sans failles. Féru d’Histoire, apôtre de la mémoire, il s’est intéressé aux éléments constitutifs de leur mythe, plongeant à leur essence. Dans une recherche sociologique et introspective, il parvient finalement à nous livrer le témoignage d’une ferveur religieuse autour d’une discipline profane, analysant ainsi ces épreuves au prisme du lieu de culte. De la sorte, il distingue le mythe du Poggio de la mode du gravel, et décrit par l’Histoire le chemin de croix attendant les Strade Bianche, sur la route de la canonisation. Entretien.
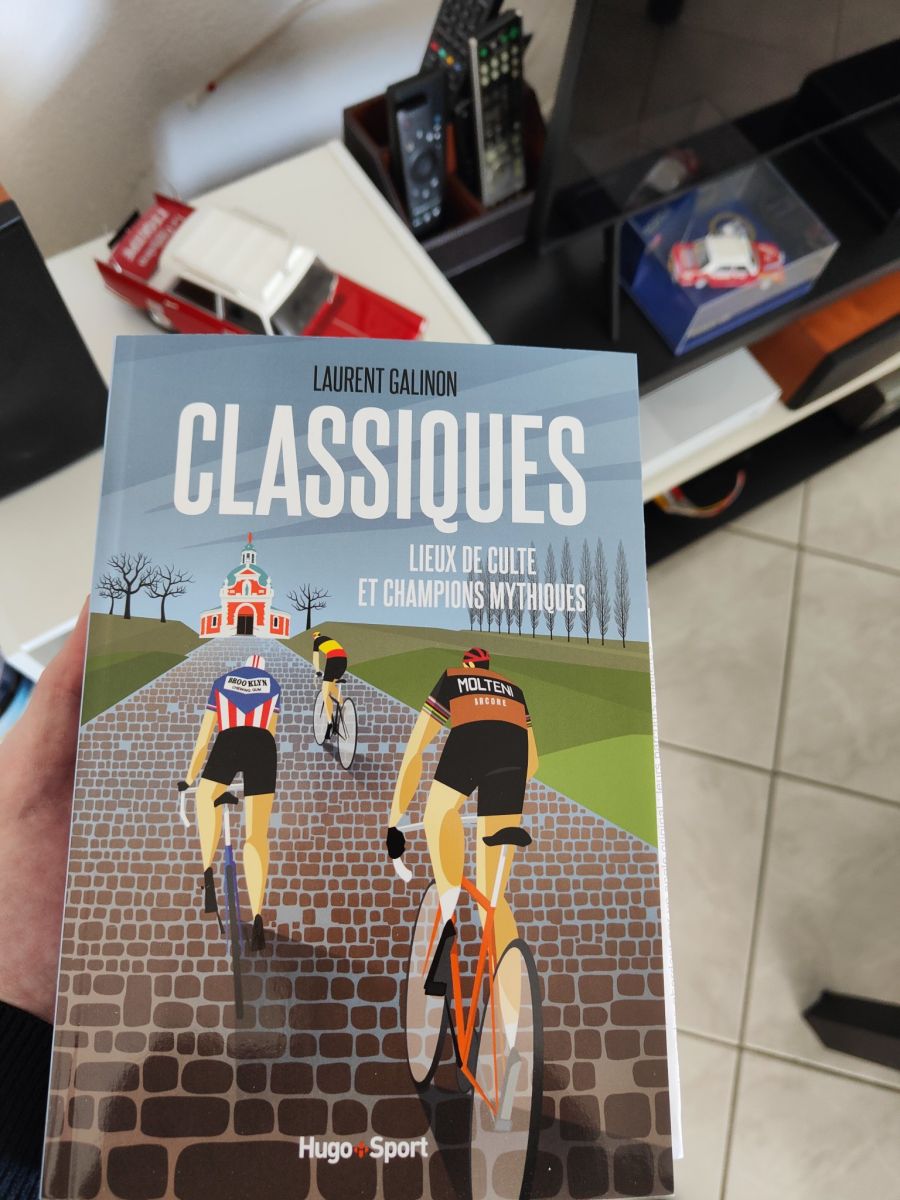 Classiques, premier ouvrage de Laurent Galinon, paru aux Editions Hugo Sport | © Editions Hugo Sport
Classiques, premier ouvrage de Laurent Galinon, paru aux Editions Hugo Sport | © Editions Hugo Sport
Interview exclusive de Laurent Galinon
Tout d’abord, pourriez-vous narrer votre parcours professionnel ?
Bien sûr. Alors j’ai commencé par une école de journalisme à Tours, avant de m’orienter vers une école spécialisée dans le documentaire, à Cannes, à proximité de la frontière italienne. Risqué, ce choix me permettait en fait de m’approcher de Silvio Berlusconi et de son personnage de guignol qui aiguisait ma curiosité jusqu’à en faire le sujet de mon premier documentaire. Nourrie par le Giro et ses paysages, ses coureurs, sa langue, ma passion pour l’Italie s’est aussi étendu au cinéma transalpin. Malgré ce véritable tropisme pour la culture italienne, sans aucun lien de sang, je suis ensuite allé m’installer à Paris, où j’ai travaillé pour à la rédaction de LCI. Désireux de me retrouver derrière la caméra, j’ai alors participé à la réalisation d’émissions de patrimoine pour France Télévisions. Un jour, j’ai appris que France 2 recrutait un correspondant à Rome. J’ai naturellement sauté sur l’opportunité. A mon retour à Paris, j’ai choisi de quitter le journalisme « pur » pour me consacrer à l’écriture de divers scenarii, courts-métrages, web séries mais aussi des documentaires sur le cyclisme que je consacre à des personnalités qui me fascinent comme Davide Rebellin ou Bernard Hinault.

Cette passion pour l’Italie nourrit toujours votre travail…
En effet, et elle tourne entre cyclisme et cinéma ! J’ai appris à lire l’Italien avec la Gazzetta dello Sport et à le parler grâce à Fellini et Mastroianni auquel je rends hommage au cours de nombreuses conférences sur le cinéma italien. Mais mon coup de cœur pour les classiques m’a aussi attaché à la Flandre, dessinant ainsi mon équilibre de vie, d’un bout à l’autre de l’Hexagone.
Dans ces pays, vous adulez un certain nombre de « lieux de culte », mystifiés par la course cycliste, concentrant les thèmes de vos œuvres audiovisuelles.
Effectivement, je crois que la plupart des tournages de mes documentaires ont lieu sur les classiques. Je suis profondément attaché à ces courses-là, et le printemps 2020 a d’ailleurs constitué un vide total dans ma vie. Ces épreuves m’obsèdent, m’incitent à m’imprégner de leurs lieux, de la langue du pays, un rapport particulier tissé au fil du temps, lors de mes reportages ou bien avec des amis, lors de séjours plus personnels où l’on roule à vélo sur les routes des Classiques. Cet univers des Classiques m’a toujours dépassé et fasciné, depuis l’enfance. C’est quelque chose que je ne peux pas expliquer, quelque chose de mystique. D’ailleurs, toutes ces courses sont en vérité une véritable messe populaire.
Cette ferveur printanière fut elle bouleversée lors du Paris-Roubaix automnal ?
Franchement non, j’ai assisté à la course sur quatre lieux, notamment Arenberg et le Vélodrome et y ai retrouvé la même ferveur, voire la même fureur que les années avant Covid.
Et d’un point de vue temporel ?
Je dirais que le rapport intime du supporter à la course n’a pas changé, contrairement à celle du journaliste, contraint de s’adapter pour avoir accès à des coureurs de plus en plus protégés par les attachés de presse. En réalité ce que je crains le plus, ce sont les « innovations » apportées par Flanders Classics (société organisatrice de la plupart des courses flandriennes, dont le Tour des Flandres). Les hideuses barrières mises en place à l’arrivée ou l’installation de barnums VIP le long du Vieux Quaremont sont des exemples notables d’une lente dérive. Ces fameuses tentes, réservés aux dirigeants et cadres de grandes sociétés flamandes, se sont multipliées de manière exponentielle ces dernières années sur le parcours, et le prix du couvert pour y accéder est apparemment encore plus élevé que celui annoncé dans mon livre ! En fait, ces endroits privatisés distinguent la plèbe et les patriciens. Elles éloignent les vrais supporters au profit des sponsors. Et je crains même que Flanders Classics ne donne de mauvaises idées à d’autres courses… Le risque serait que les classiques flandriennes se rapproche du gigantisme du Tour avec le risque majeur de perdre une certaine authenticité, une vraie simplicité et à la fin le charme désuet de ces courses du Nord. Flanders Classics est pourtant capable de repenser le spectacle de la course de manière attrayante, comme situer le départ du Het Nieuwsblad dans le bouillant vélodrome de Gand, où bat véritablement le cœur du cyclisme belge depuis 120 ans.
Vous tissez la comparaison entre Tour des Flandres et Tour de France. Selon vous, qu’est-ce que les classiques ont de plus que les Grands Tours ?
C’est une bonne question… Je crois qu’il y a la fulgurance du moment. Tout se joue sur un coup de dés. Le Tour, ces dernières années, ressemble de plus en plus à un problème d’algèbre – bonifications, watts, écarts, course aux points pour le maillot vert et à pois – alors que les classiques incarnent la littérature du cyclisme, un poème de quelques heures, avec ses attitudes romantiques désespérées, ses drames. Celui par exemple de Sep Vanmarcke, promis à la gloire et qui ne remportera sans doute jamais la moindre classique. C’est aussi de la peinture : il y a dans le ciel des Flandres, dans les paysages littoraux de Milan – San Remo, une vraie dimension picturale, dépassant celle du Tour de France. Sur la Grande Boucle, un coureur pédalant dans la majesté des Alpes, encouragé par la foule, c’est très beau et cela fait consensus. En revanche, la classique réussit l’exploit de transfigurer des paysages profondément déprimants. Les coureurs subliment des champs de betteraves à perte de vue, des peupliers dénudés, des bas-côtés remplis de boue, des fermes. La classique réussit à les faire passer pour des paysages de peinture, à attirer une foule vers des lieux dénués d’atouts touristiques. Tous ces lieux ont alimenté ma mythologie intime depuis l’enfance et me conduisent à les consacrer aujourd’hui.

J’imagine que vous évoquez également les faubourgs de Liège, traversés par l’arrivée de la Doyenne.
Si je n’ai pas connu l’ancienne arrivée dans le centre-ville de Liège, boulevard de la Sauvenière, je me suis en revanche attaché aux usines de brique rouge, aux vitres cassées symbolisant leur abandon à proximité de la côte de Saint-Nicolas, dans la commune de Ans. Pour moi, ce décor représentait la Doyenne. Désormais, le déplacement de l’arrivée sur le quai d’Avroy a détruit ce mythe pictural. Il faudra des années pour y reconstruire un lieu de culte. Je fais le parallèle avec Meerbeke, où le Tour des Flandres s’achevait jusqu’en 2011. C’était une petite ville quelconque, dont le choix a suscité l’incompréhension de prime abord, avant d’être associée aux exploits de Johan Museeuw, Peter Van Petegem ou Tom Boonen. Son abandon au profit d’Oudenaarde a fini par susciter l’ire des supporters, ce qui souligne qu’entre 1973 et 2011, cette arrivée repoussante s’était muée en lieu de culte. Moi j’assume ce côté conservateur de musée, il faut protéger les lieux tels qu’ils sont pour que l’Histoire s’y répète ou s’y réinvente.
Alors, comment entrer dans l’Histoire ?
Il faut distinguer le mythe et la mode. Si les Strade Bianche ont aujourd’hui la côte, quid de l’avenir du vintage, du concept « de course antique » ? Est-ce que dans 20 ans le gravel ne sera pas dépassé ? Qui nous dit que dans 20 ans, la mode ne sera pas aux arrivées sur des bretelles d’autoroute ? Pour devenir une vraie classique, les Strade Bianche doivent surmonter l’épreuve du temps. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, Paris-Roubaix a failli disparaitre, victime du macadam. Ça ne s’est vraiment joué à rien !
Vous parlez ainsi du poids de l’Histoire. Comment devient-on un monument ?
Pour moi, tout est affaire de décor et de légendes. Le paysage, évidemment, j’en parle beaucoup dans le livre. Mais surtout le halo de mystères qui entoure le déroulement d’une course. Les classiques ne sont pas un fait, mais le fruit d’une mythologie, d’autant plus qu’elles sont nées à une époque où l’absence d’appareils photos et de caméras ne posait aucune contrainte au récit. Les monuments se construisent ainsi sur ces narrations d’exploits, de polémiques, de mystères et de drames, toujours sur un fil entre l’épopée et la tragédie. C’est une rencontre entre Homère et Napoléon, la tragédie grecque d’une destinée qui se fracasse sur le champ de bataille.
A cet égard, quels atouts possèdent Strade Bianche pour espérer devenir, un jour, le « 6e Monument » ?
Tout d’abord, il y’a là un décor idéal aux fantasmes cyclistes ! Avec ces collines et ces cyprès, les coureurs évoluent dans un tableau du Quattrocento. Avec ses « routes blanches » les Strade possède sa propre singularité, c’est primordial car on sait que chaque Monument a sa spécificité. Pour le Tour des Flandres, ce sont les Monts, Paris-Roubaix les pavés et Milan – San Remo son fameux Poggio, faisant basculer en une fraction de secondes la course de l’ennui à la folie. A mon avis, la seule chose qui fait défaut aux Strade Bianche, c’est l’Histoire, son vertige, dans un sport où la mémoire est prééminente. Le gravel est une mode. Les modes sont destinées à mourir alors que les mythes leur survivent. Il faudra voir si les coureurs d’aujourd’hui deviennent des mythes de demain et donnent aux Strade Bianche ses lettres de noblesse. Aujourd’hui la mode tend à déprécier Milan – San Remo, parce que la durée de la retransmission TV génère de l’ennui. Pourtant, cette course propose de fantastiques contradictions, entre la longueur de son déroulement et la rapidité de son dénouement, entre de l’ennui et l’excitation.

D’ailleurs, Milan – San Remo conserve chaque année un plateau de même standing, garantissant son prestige. Quand on demande à Arnaud Démare ce que son gain a changé pour lui, il vous répondrait presque que c’est sa vie qui en a été changé.
C’est évident ! On en a l’illustration avec l’effervescence entourant la participation de Tadej Pogacar à la Primavera. On se met à rêver de panache, à convoquer l’échappée au long cours de Claudio Chiappucci en 1991. On en revient toujours à ce rapport intime avec la mémoire du sport, au besoin d’épopée. 100 ans d’histoire séparent les Strade et la Primavera, c’est ça la différence majeure entre les deux classiques italiennes.
Cette traditionnelle arrivée au sprint a d’ailleurs été déjouée ces dernières années par une nouvelle génération de coureurs offensifs, et ce sans changement de tracé. A cet égard, pensez-vous que Milan – San Remo est un miroir du cyclisme contemporain ?
Absolument ! Milan – San Remo a vu son rythme s’accélérer sous l’impulsion d’une nouvelle génération qui s’est approprié le Poggio, pour lui donner un éclat nouveau, plus spectaculaire, après des années plus ou moins apathiques ; vingt ans d’arrivées au sprint de Zabel jusqu’à Démare. Cette génération est formidable pour ça, elle réinvente l’inédit, même si on ne sait pas ce qu’il en restera.
Mais justement, la mémoire de Julian Alaphilippe, Wout Van Aert ou Mathieu Van der Poel ne pourrait-t-elle pas être nourrie par la légende postérieure des Strade Bianche ?
Je répondrais par une comparaison : au milieu des années 60, Felice Gimondi, figure émergente du peloton, est promis à dix ans de règne sans partage. Après son succès sur le Tour de France 1965 et Paris-Roubaix 1966, sa légende est en marche. C’est alors que surgit Eddy Merckx qui va effacer Gimondi ! Le « Cannibale » nous a même fait oublier Walter Godefroot ou Freddy Mertens. Si Pogacar règne durant dix ans, se souviendra-t-on de ses concurrents ? Et qui nous dit qu’il ne sera pas qu’une vedette éphémère, bientôt renversée par un coureur encore plus fort que lui ? A travers mon livre, j’essaie justement d’évoquer les autres coureurs, ceux qu’on a oublié, qui ont été effacés au fil du temps afin de rééquilibrer la mémoire. Mis à part les Belges, qui se souvient d’Eric Vanderaerden et de sa victoire miraculeuse sur le Tour des Flandres 1985 ? Cette édition entière est tombée dans les oubliettes de l’Histoire du cyclisme en France. Alors que restera-t-il de Pogacar et de sa longue cavalcade solitaire sur les Strade Bianche dans vingt ans ?

Dans « Classiques », votre premier ouvrage, paru en février aux Editions Hugo Sport, vous décomposez chaque Monument en lieux de culte, chacun formant un chapitre. Cette dimension biblique s’étend également à la métaphore que vous filez en avant-propos, et me pousse à vous demander à quel point le cyclisme s’inscrit dans une dimension religieuse.
Pour moi le parallèle est évident. Il y a les vainqueurs et les vaincus, les saints et les damnés. Le dieu et ses apôtres, le leader et ses gregari. Le chemin de croix, le Kruisweg. Ces lieux de culte sont de véritables chemins de pèlerinage qui rassemblent des gens du monde entier sur des routes anodines. C’est la force des lieux, l’esprit des lieux, qui draine la passion. Au lieu de faire une Histoire chronologique, je me suis laissé cette liberté de rentrer dans les classiques par les lieux, qui forgent les souvenir et se transforment en places mythiques. En fait, cette construction provient directement de ce que je ressens à l’égard des classiques, à mon attachement à leurs lieux. Leurs lieux de culte.
Par Jean-Guillaume Langrognet











