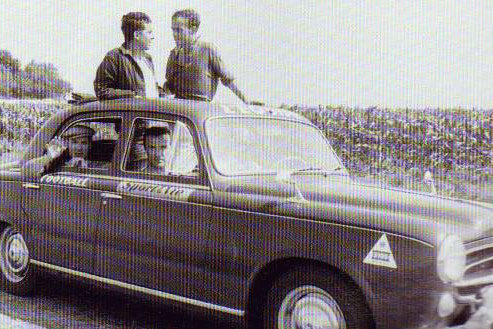
Luchon, 13 juillet 1971 – Luis Ocaña n’était peut-être pas intrinsèquement le meilleur de cette course, mais il en était le soleil, formant d’ailleurs avec l’astre lui-même un couple indissociable, dont la chaleur et le rayonnement complémentaires nous éblouissaient depuis quatre jours. Il aura suffi que le ciel se couvre durant vingt minutes sur les Pyrénées pour qu’un bref cyclone, aux dimensions d’un cataclysme, couche au sol notre bel épi gorgé de lumière, qui s’apprêtait pourtant à retrouver là son terreau et son terroir de prédilection pour notre plus grande joie.
Le déluge fut, dit-on, envoyé sur la terre en punition de la folie des hommes. Depuis la veille, il régnait effectivement une certaine démence sur les premiers rangs du Tour de France, à la suite d’un accès d’énervement de Merckx, prolongé par des déclarations malheureuses de son directeur sportif Driessens et répercuté par quelques reporters trop enclins à se travestir pour la circonstance en correspondants de guerre – des télégrammes venus de Flandre et du Brabant assaillaient les organisateurs, leur reprochant vertement de favoriser la victoire d’Ocaña –, cependant que les partisans de celui-ci menaçaient de faire un malheur si l’on ternissait d’un soupçon, au reste immérité, la loyauté de leur champion.
Comme le parcours devait s’offrir, hier après-midi, un petit tronçon dans la province de Lerida, on appréhendait le pire, un conflit entre la Belgique et l’Espagne, l’une envahissant l’autre pour une sorte de « kermesse héroïque » à rebours, où des affronts vieux de trois siècles se fussent lavés. Les routiers d’expérience voyaient déjà les pavés voltiger en direction des voitures, comme cela s’est déjà produit dans ces régions.
Dès le début de l’étape, il apparut que le climat de la journée serait bien aux hostilités déclarées. On cogitait, on gigotait avec une émulation meurtrière dans les troupes rivales de Merckx et d’Ocaña. Déjà, le fil de la compétition avait décanté le contingent, et, sur les pentes du Portet d’Aspet, les deux chefs avaient jeté les bases d’un duel au soleil qui livrerait un verdict capital à Luchon. C’est alors que les nuages commençaient à s’accrocher aux branches des sapins, plongeant la vallée dans cette atmosphère électrique et glauque qui prélude au tonnerre de Dieu. Suivirent deux ou trois éclairs mous, puis ce fut, en un instant, le typhon ravageur, la route coupée par des cataractes ou les charriant devant soi, le paysage comme secoué par un immense sanglot. On n’y voyait pas à un mètre, des chocs sourds ébranlaient les véhicules : nous attendions des pavés, c’étaient des grêlons.
La course cycliste, qui ne s’est jamais confondue avec une promenade de santé, renouait avec l’une des faces les plus aventureuses de sa vocation qui l’apparente à une navigation, tributaire des éléments, éventuellement des raz de marée. Les favoris, qui s’apprêtaient à franchir le col de Mente, s’étaient frileusement regroupés pour former un peloton de Noé, comme on dit l’arche, où chaque espèce était représentée : un Bic (Ocaña), un Molteni (Merckx), un Sonolor (Van Impe), un Flandria (Zoetemelk), un Mercier (Guimard), un Ferretti (Petterson)… non pas en vue de la reproduction, mais dans l’attente du rameau d’olivier qu’une colombe ne manquerait pas de leur tendre, quand les eaux se retireraient.
Au moment où l’arc-en-ciel s’annonça, Ocaña gisait dans l’ambulance, et les habitants de Saint-Beat applaudissaient, en pleurant, au passage de son convoi terriblement silencieux. Nous plongions alors vers cette frontière montagnarde, amicale et complice, de part et d’autre de laquelle on parle déjà l’espagnol en France, encore le français en Espagne, à l’image de celui qui s’en allait en emportant le maillot jaune avec lui. Quinze kilomètres le séparaient de son pays natal, où l’attendaient des banderoles désormais dérisoires ; trois jours le séparaient de l’apothéose de Mont-de-Marsan, où il ne fait aucun doute qu’il fût entré revêtu de la casaque principale. Un deuil, immense, aux arrière-goûts de frustration et de trahison, s’abattit sur la troupe rendue à l’unanimité.
Car le rameau d’olivier existait quelque part. Nous l’avons trouvé dans la bouche d’Eddy Merckx, tout de blanc vêtu, qui refusait à l’arrivée d’endosser le maillot jaune, estimant qu’il ne le méritait pas, et remâchant, avec une sportivité sublime, cette sorte de défaite que constitue pour un vrai champion une ombre portée sur sa victoire.
Cependant Ocaña était hissé dans l’hélicoptère et déposé sur le terrain des sports de Saint-Gaudens, où nous songions à la belle phrase de Giraudoux dans Pleins Pouvoirs : « L’ovale d’un stade est pour le sportif la plus belle illustration de l’intégrité et de la pureté. »
Car, à cet instant, il était encore un athlète. Tout à l’heure, à l’hôpital, il serait un blessé, et demain, peut-être, un malade. Demain où le soleil, lui, se relèvera quand même.
Antoine Blondin











