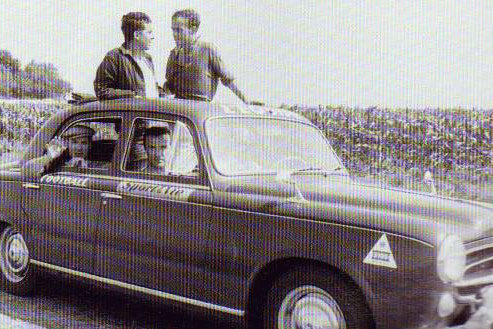
Luchon, 8 juillet 1964 – La pureté de l’exploit accompli par Raymond Poulidor dans le col de verdure du Portillon constitue un gain précaire sur la montagne. Cette petite conquête, qui devrait nous ravir sans partager, se trouve compromise par l’annonce de la mort de Charles Bozon (NDLR : champion du monde de ski et alpiniste, mort dans une avalanche à l’aiguille Verte) et de ses camarades au flanc d’autres montagnes. Si les Pyrénées riment pour un soir avec les Alpes, ce n’est pas dans la joie mais dans le trouble.
Un champion du monde ne disparaît jamais complètement. Il ne laisse pas deux dates sur la pierre comme le commun des mortels, mais une seule : celle qui donne son label à sa carrière. Rapprocher la course de Poulidor de la dernière ascension de Bozon peut sembler dérisoire. L’une et l’autre témoignent pourtant de la même volonté d’apprivoiser une planète qui se révèle en définitive parfaitement hostile.
Quand le Tour de France réussit, comme hier, son décollage, quand les hameaux rétrécissent et qu’on voit les sapins par en dessus, quand les fumées se dissipent avant de vous atteindre, la solitude peuplée de rumeurs qui est alors celle de l’homme en marche prend l’aspect d’une sublimation. Ainsi veut-on penser que Charles Bozon et ses camarades se sont taillés un dernier royaume.
Le ski n’est pas en soi un défi mais un accomodement, l’escalade est une gageure. Par là, elle s’apparente au cyclisme qui est un levain de tentations. Le besoin d’arpenter l’univers et d’aller jusqu’au bout est un vieux rêve qui nous est cher. Le coureur et l’alpiniste sont nos délégués. Leurs investigations et leurs performances nous concernent immédiatement. Ils portent nos couleurs dans les trois dimensions et dilatent cette terre des hommes à quoi nous sommes apparemment trop attachés.
Une chape frileuse s’est abattue soudainement sur la course, lorsque nous avons appris que le deuil s’instaurait au-delà de nos horizons. Cpendant, Poulidor allait son grand bonhomme de chemin et donnait, malgré tout, à cette journée sa raison d’être, en appelait d’autres à venir. Cet effort têtu de celui qu’on donnait la veille pour vaincu rétablissait l’image de la continuité.
Nos forces vives se dilapident moins qu’elles ne se concentrent. En quelque domaine que ce soit, tout concourt au meilleur bien. Il y avait encore du bonheur à suivre un champion dans sa plongée sur Luchon et l’allégresse de la foule plaidait pour une conception du monde qui donne sa place à la revanche sur le sort.
L’oppressante vallée où nous campons ce soir étalonne à son juste prix l’entreprise de ceux qui tentent de franchir les barrières naturelles ou de s’en affranchir. Elle nous rappelle que l’art de vivre est d’abord un système de communication entre les êtres. Répondre à la tentation par la tentative est le lot des plus forts. Ceux-ci se confondent en un même paradis.
Qu’il ne fasse pas demain jour pour Charles Bozon ou qu’il se lève une aube radieuse pour Poulidor, c’est au bout du compte un seul et unique moment d’une aventure pathétique qui est la nôtre et dont les reflets sont étincelants.
Antoine Blondin











